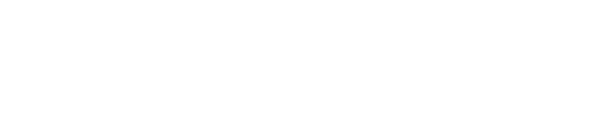Nouvelle taxe sur les holdings patrimoniales
LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2026 PRÉVOIT LA CRÉATION D’UNE TAXE INÉDITE SUR LES ACTIFS PATRIMONIAUX DÉTENUS PAR LES SOCIÉTÉS HOLDINGS, AVEC UN CHAMP D’APPLICATION PARTICULIÈREMENT LARGE.
SOUS COUVERT DE JUSTICE FISCALE, LE TEXTE S’INSCRIT DANS UNE TENDANCE PLUS LARGE DE RESSERREMENT DES DISPOSITIFS DE FAVEURS BÉNÉFICIANT AUX HOLDINGS PATRIMONIALES, AMORCÉE AVEC LE RECENTRAGE DU PACTE DUTREIL SUR LES SEULES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.
DERRIÈRE CETTE ÉVOLUTION, UNE MÊME PHILOSOPHIE : LIMITER LES AVANTAGES FISCAUX LIÉS AUX STRUCTURES DE DÉTENTION PUREMENT FINANCIÈRES ET ENCOURAGER LE RÉEMPLOI DU CAPITAL DANS L’ÉCONOMIE RÉELLE.
CETTE TAXE, BIEN QUE NON VOTÉE POUR LE MOMENT, MÉRITE TOUTE NOTRE ATTENTION AU REGARD DES CONSÉQUENCES POTENTIELLEMENT TRÈS LOURDS QU’ELLE ENTRAINERAIT POUR LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS.
I. Une taxe « anti-holdings » dans la lignée de la taxe Zucman et du recentrage du Pacte Dutreil
L’inspiration est claire : le gouvernement reprend la logique des travaux de Gabriel Zucman, prônant une imposition du patrimoine financier inemployé. L’enjeu dépasse la seule technique fiscale : il s’agit d’un changement de paradigme, où la détention patrimoniale passive devient une source d’imposition en soi.
Champ d’application : les holdings patrimoniales visées
Sont concernées :
Les sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés, et
Les sociétés étrangères équivalentes, dès lors qu’une personne physique contrôlante est domiciliée en France.
Les conditions cumulatives d’assujettissement à la date de clôture de l’exercice sont les suivantes :
Valeur vénale des actifs > 5 M€ ;
Contrôle par une personne physique (directement ou via son cercle familial) détenant plus de 33,33 % des droits financiers ou de vote, ou exerçant le pouvoir de décision de fait ;
Revenus passifs > 50 % des produits totaux (dividendes, intérêts, loyers, plus-values, redevances, etc.).
Plusieurs actifs sont exclus du champ d’application de la taxe : les SICAV, sociétés de capital-risque, SIIC, organismes étrangers assimilés...
II. Une assiette large et une mécanique redoutable
Le texte instaure une taxe de 2 % sur la valeur vénale nette des actifs financiers non affectés à une activité opérationnelle.
Composition de l’assiette
L’assiette comprend :
Les titres de placement, obligations, créances, liquidités ;
Les biens meubles et immeubles non affectés à une activité économique.
Les dettes contractées pour l’acquisition de ces actifs sont déductibles, mais sous conditions strictes, inspirées des règles de l’IFI.
Sont exclus de la base imposable :
Les titres de participation au sens de l’article 219, I-a quinquies du CGI ;
Les titres de jeunes PME européennes répondant à des critères d’activité et d’ancienneté ;
Les investissements productifs ou innovants (FCPR fiscaux, SCR, SLP, etc.).
CAS PRATIQUE
Un dirigeant cède sa société pour 15 M€, placés sur des comptes à terme rémunérés à 4 % via sa holding patrimoniale.
Produit annuel : 600.000 € d’intérêts.
Taxe sur la valeur des actifs : 2 % x 15 M€ - 15% = 255.000 €.
Impôt sur les sociétés : 25 % x 600.000 € = 150.000 €.
Soit 405.000 € d’impôts pour 600.000 € de produits, soit un taux effectif de 67,5 %.
Et si la rémunération des placements baisse, le taux d’imposition global peut dépasser 100 % des revenus générés — un niveau économiquement et juridiquement difficilement soutenable.
III. Une mesure constitutionnellement fragile
Cette nouvelle loi nous semble, en l’état, non conforme à la Constitution (ainsi qu’au droit Communautaire) et notamment pour les raisons suivantes :
Atteinte à la faculté contributive
L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen impose que tout impôt soit proportionné à la faculté contributive du redevable.
Or cette taxe frappe la valeur du patrimoine, indépendamment de tout revenu effectif.
Une société détenant des actifs peu ou pas productifs supporterait donc une charge fiscale sans aucune ressource correspondante.
Caractère confiscatoire
Combinée à l’impôt sur les sociétés, la taxe pourrait absorber la quasi-totalité — voire l’intégralité — des revenus tirés du capital.
Ce cumul entraîne un effet confiscatoire contraire à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel. Surtout, aucun bouclier fiscal n’est prévu pour plafonner le cumul de la taxe et de l’IS à un pourcentage des revenus générés.
IV. Quelles stratégies pour anticiper ?
Face à ce dispositif, l’anticipation est essentielle.
Les dirigeants concernés doivent dès à présent analyser la nature des revenus de leurs holdings et envisager des réorganisations ciblées.
a. Scinder les structures de détention
Créer plusieurs holdings autonomes dont les actifs demeurent en dessous du seuil de 5 M€ permettrait, sous réserve de substance économique réelle, de rester hors champ.
La démarche doit être motivée par une logique patrimoniale cohérente, pour éviter toute requalification en abus de droit (article L. 64 LPF) - par exemple en raison d’une pluralité d’enfants...
b. Maitriser les flux financiers
Transformer la société de détention en holding de facturation — via par exemple une centralisation de fonctions support ou des management fees — pourrait permettre dans certains cas de repasser sous le seuil des 50 % de revenus passifs.
Conclusion
Cette nouvelle taxe (si elle était adoptée) marquerait un tournant politique et fiscal majeur et pourrait modifier en profondeur les stratégies fiscales et patrimoniales utilisées jusqu’alors.
Dans ce contexte mouvant, la clé reste la même : anticiper, sécuriser et structurer.
Notre cabinet accompagne aujourd’hui de nombreux dirigeants dans la modélisation et la restructuration de leurs holdings, pour concilier efficacité fiscale, logique patrimoniale et pérennité familiale.
Article écrit par Clément Rozant.
À PROPOS DES AUTEURS
CLÉMENT
Rozant
ASSOCIÉ FONDATEUR
AVOCAT À LA COUR
Clément a commencé sa carrière en janvier 2010 au sein du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre avant de fonder le cabinet Rozant & Cohen en novembre 2015.
AUTRES ARTICLES DU CABINET